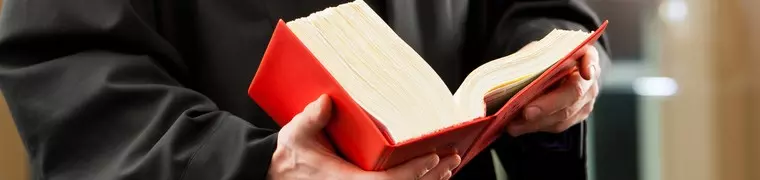
Le principe de minimisation du dommage dans d'autres systèmes juridiques
Le principe de l'obligation de minimiser le dommage pour la victime, tel qu'il est appliqué au Royaume-Unis par exemple, est simple : en cas de dommage subis par une victime cette dernière à droit à la réparation intégrale de son préjudice afin qu'elle soit remise dans des conditions équivalentes à celles existantes avant la réalisation du dommage. Jusqu'ici le principe est le même que celui appliqué par les juridictions françaises, c'est celui de la réparation sans perte ni profit.
Différences avec le système français
Les choses diffèrent par la suite puisque au Royaume-Unis le responsable du dommage, délictuel ou contractuel, pourra prouver que la victime n'a pas pris toutes les mesures nécessaires dans le but de limiter l'étendue de ses dommages. Attention ces mesures doivent être raisonnables et relèvent plus du bon sens que de la contrainte pour la victime. Celle-ci devra alors expliquer au juge la raison de ses agissements, ou de son inaction, qui décidera si le comportement a été raisonnable. Dans le cas contraire la victime pourra voir, en fonction de l'interprétation des faits faite par le juge, l'indemnisation de son dommage diminuée, proportionnellement à son comportement déraisonnable.
La position de la Cour de cassation française
En France les juges du quai de l'horloge se refusent, de manière constante, à assimiler l'absence de minimisation du dommage de la victime à une faute, entraînant de ce fait une diminution de son indemnisation.
Exemple jurisprudentiel : arrêt du 2 juillet 2014
La dernière décision en date de la Cour de cassation à ce sujet remonte au 2 juillet 2014. En l'espèce une SCI, sur les conseils de notaires, avait fait l'acquisition d'un logement en VEFA sur l'Île de la Réunion, dans le but, entre autres, de profiter des avantages fiscaux offerts par l'administration à cette époque.
Cependant en l'absence de transparence fiscale, la société n'avait pas pu bénéficier des réductions d'impôts espérées. Alors que l'administration fiscale s'était tournée vers les associés de la SCI, afin de leur proposer une rectification fiscale, et de profiter ainsi d'une autre réduction d'impôts, ces derniers avaient refusé et préféré se retourner contre les notaires, en réparation de leur préjudice, pour défaut d'information et de conseil.
Motivation de la Cour de cassation
Condamnés en appel pour ces motifs, les notaires avaient alors formé un pourvoi en cassation, estimant qu'en « en refusant l'application du dispositif proposé par l'administration fiscale, qui aurait permis de prévenir ne serait-ce qu'en partie la réalisation du préjudice lié à la perte du bénéfice fiscal de faveur dont ils demandaient l'application [les associés de la SCI] avaient commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité ». Ils invoquaient ainsi l'absence de comportement raisonnable des victimes qui avaient refusé d'agir, de telle sorte que le dommage aurait pu être amoindri.
Si l'argumentation n'était pas vide de sens, les magistrats de la Haute juridiction avaient pour autant refusé de l'entendre, énonçant, sans surprise au vu de leurs précédentes jurisprudences, que « Vu l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».
C'est donc en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice que l'argument visant à reconnaître la « mitigation » du dommage (son absence de minimisation par la victime), est rejeté.
Perspectives de réforme
Cependant il est possible que cette jurisprudence ne soit bientôt plus applicable au vu du projet de réforme de la responsabilité civile qui est en marche. En effet il est possible que cette obligation, pour la victime, de limiter son dommage fasse son apparition dans le Code civil. C'est donc sous la forme suivante que le principe est actuellement proposé : « Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ». Notons que dans ce cas la victime ne pourrait pas être tenue de porter atteinte à son intégrité physique, en s'obligeant à subir une intervention chirurgicale par exemple, afin de ne pas voir son indemnisation limitée, cela dans la logique de la notion de dignité du corps humain prévue par l'article 16-3 du Code civil.
Importance de la jurisprudence en assurance
La jurisprudence de l'assurance est essentielle pour interpréter et appliquer les dispositions du Code des assurances, en clarifiant les obligations, les conditions de couverture, et les exclusions. Les décisions judiciaires permettent d'ajuster les règles aux évolutions des pratiques et de garantir que les pratiques des assureurs respectent les principes du Code.